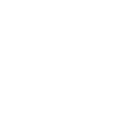Écoute et présence
Écoute et présenceDans la vie les gens se parlent. Ils ont besoin de se parler, de tout et de rien ou de choses plus importantes.L’échange social commun est la trame même de l’existence sociale et psychologique. Cependant, l’échange est toujours ritualisé, conventionné, institué et réglementé : d’une part il indique la position sociale de chaque partenaire, et d’autre part l’abstinence est de règle.Chacun joue avec les positions sociales et ce qu’il s’autorise. Parler à son père ou à un ami ou à son voisin, ce n’est pas la même chose (positions sociales), et de toute façon, ce qu’on dit ou ce qu’on ne dit pas contribue à définir la relation (abstinence).La ritualisation définit donc des espaces de parole : privé ou public, intime ou familier, professionnel ou amical, amoureux ou utilitaire, etc. Chacun espère que ces espaces de parole, nombreux et variés, soient suffisants pour soutenir l’existence quotidienne.Quand surviennent des troubles, des maladies ou des problèmes, c’est plus difficile de trouver un espace de parole soutenant. L’autre étant toujours un reflet de soi-même, la rencontre avec soi (l’autre) devient difficile. On peut finir par être institué comme « le souffrant », « le malade », « le maillon faible » et par être dévalorisé dans cette position.C’est le propre de la rencontre clinique de créer un espace où l’autre n’est plus un simple reflet de soi-même, mais un révélateur de soi-même.L’écoutant doit accepter de ne pas s’engager dans la relation de façon réciproque, identificatoire. Il n’est pas si facile de définir cette qualité particulière de l’écoute où on renonce à s’appuyer sur l’identification à l’autre. Le premier, Freud a parlé de neutralité bienveillante et d’attention également flottante.Au départ de sa réflexion, la neutralité bienveillante était sans doute une attitude qui s’imposait dans la rencontre du médecin avec le malade. Neutralité dans la mesure où le médecin doit pouvoir se concentrer sur les symptômes et les signes de la maladie sans que cela l’affecte ; il a besoin de toute sa raison pour comprendre ce qui se passe, quelles que soient la souffrance et les émotions du patient.Bienveillance parce que le malade est en souffrance et qu’un minimum d’empathie est nécessaire pour qu’il accorde sa confiance au médecin, qu’il puisse dire ce qu’il ressent et soit encouragé à contribuer à sa guérison. L’attention également flottante s’est imposée par la suite, lorsque Freud décide d’écouter ce que disent les malades névrosés, parce qu’il s’est rendu compte que ce qu’ils disent spontanément contient implicitement la vérité cachée de leur maladie, de leur existence, de leur souffrance.Pour pouvoir l’entendre et l’interpréter à bon escient il est nécessaire d’avoir une écoute « flottante », c’est-à-dire qui se tient à une certaine distance du vécu immédiat et qui tente de capter les signes que l’inconscient manifeste dans le discours. C’est par ces signes entendus que le malade accédera lui-même à sa vérité. Cette écoute psychanalytique est difficile parce qu’on est toujours tenté de comprendre trop vite et de n’entendre que ce qui va dans le sens de la conception qu’on se fait des problèmes du patient.Freud ira même jusqu’à dire que non seulement il faut pouvoir renoncer à apprendre au malade ce qu’il devrait faire, mais qu’il faut aussi pouvoir renoncer à le guérir, dans la mesure où l’envie de guérir l’autre ne peut qu’encombrer le processus de son autoguérison.Les psychanalystes apprennent cette écoute spécifique par leur psychanalyse personnelle : c’est parce qu’eux-mêmes ont pu dire des choses qui leur échappaient et que ces choses ont été entendues qu’ils deviennent capables de se taire et de laisser la place aux dires de leurs patients.On a trop souvent pensé que la psychanalyse ne reposait que sur l’interprétation du psychanalyste : le patient parlerait, ne sachant pas ce qu’il dit ; le psychanalyste lui dirait le sens caché de ses paroles.C’est une vision fausse et réductrice de la cure psychanalytique qui met le psychanalyste en position de pouvoir excessif. Si l’on s’en tenait à cela, le patient ne serait guéri que quand il serait entièrement d’accord avec les interprétations du psychanalyste. C’est évidemment incompatible avec l’objectif qu’on poursuit.L’enseignement de Freud peut inspirer tout psychologue clinicien et toute approche clinique qui vise l’écoute d’autrui. Retenons qu’à partir de FREUD on s’intéresse à la parole en tant qu’elle est révélatrice du sujet pour le sujet lui-même.Ce n’est possible que si l’écoutant est dans un état de disponibilité tel qu’il suscite l’advenue de cette parole révélatrice et transformatrice. L’expérience nous montre que deux obstacles majeurs empêchent cet état de disponibilité : l’identification à l’autre et la position de « maître ». Ces deux pièges sont d’autant plus difficiles à éviter qu’ils sont sollicités par celui qui parle.L’identification à l’autre, particulièrement à son vécu émotionnel, est une des données de base de la relation humaine. Nous sollicitons toujours cette identification empathique chez autrui ; c’est par là qu’il peut marquer sa solidarité, son lien, son affection, sa sympathie, son intérêt pour nous, son amour.C’est un soutien minimum dont nous avons besoin dans la vie. Bien des relations sociales nous sont désagréables quand autrui ne manifeste pas assez à notre goût cette identification affective. Bien sûr, il y en a qui en ont plus besoin que d’autres, et il y en a qui la manifestent plus que d’autres.L’expérience clinique nous montre que lorsque nous obtenons ce plaisir minimum dans la communication avec autrui, cela a pour effet de nous soulager, mais pas de continuer à chercher en nous-mêmes ce qui nous fait souffrir. Cela opère comme un calmant, comme une aspirine : ça soulage, mais ça ne guérit pas. L’identification à l’autre finit donc par être un obstacle à prendre conscience des vrais problèmes et à les modifier.La position de « maître » est aussi sollicitée par celui qui parle de ses problèmes : « je ne sais plus où j’en suis, dis-moi ce que je dois faire ; j’avoue mon impuissance et mon incompétence ».L’expérience clinique nous montre que si on répond trop vite à cette demande, en prenant la position d’un parent, d’un enseignant, cela risque de couper la relation assez vite.En effet, d’une part celui qui sollicite l’aide s’apercevra tôt ou tard que ce qu’on lui dit, soit il le savait déjà, soit cela ne convient pas du tout, et d’autre part, si le conseil est judicieux, il se dit qu’il aurait très bien pu le trouver lui-même.En l’entendant d’un autre il contracte une dette qu’il faudra payer, d’autant plus s’il ne fait pas ce qu’on lui a dit de faire parce que quelque chose résiste en lui.Cela lui rappelle la dépendance désagréable de l’enfant et de l’élève qu’il a été. Bien des médecins généralistes se sont aperçus que la position de « maître » avait ses limites, surtout lorsqu’il s’agit de problèmes psychologiques.On peut évidemment agrémenter cette position d’autorité d’une autre, plus subtile, mais dont l’efficacité est tout aussi douteuse : soit on essaie de convaincre rationnellement le malade en lui expliquant avec conviction les bienfaits des conseils prodigués ; soit on essaie plutôt de le convaincre affectivement de la justesse de nos recommandations.En quelque sorte on fait appel, comme les parents et les enseignants, à deux formules classiques : « rends-toi compte à quel point j’ai raison » ou « fais-moi plaisir », ce qui après tout est une forme de suggestion ou de séduction. Souvent, celui qui demande conseil, quelle que soit la justesse rationnelle du conseil reçu, finit par conclure que le conseilleur ferait mieux d’appliquer ses conseils à lui-même.On n’aime recevoir de leçons de personne, même si on les demande, ce qui est le paradoxe par excellence. La vie elle-même nous enseigne que l’efficacité de ces moyens d’influence sur autrui est très limitée, particulièrement face à des problèmes psychologiques.C’est que ceux-ci sont toujours liés à des passions intérieures, par définition inaccessibles à la raison ou à l’affection d’autrui, et même à l’autorité d’autrui.C’est un peu comme si un parent essayait de convaincre son fils ou sa fille que la relation amoureuse dans laquelle il (elle) s’est engagé(e) était rationnellement inintéressante ou casse-gueule, ou comme s’il (ou elle) allait accepter de faire plaisir au parent en renonçant à cette relation. Nous savons qu’il est plus intéressant que le jeune « fasse lui-même l’expérience » de ce que peut signifier cette relation amoureuse pour lui (ou elle).Devant ces obstacles le psychologue clinicien décide donc d’écouter et de guider le processus uniquement à partir de ce qu’il entend. Dire à l’autre ce qu’on entend en écoutant de cette façon-là est déjà une interprétation pour celui qui parle.Depuis l’essor de la psychologie clinique bien des relations humaines ont espéré créer cette atmosphère d’écoute et ont emprunté les attitudes construites par les professionnels : la relation conjugale, la relation médicale, la relation amicale, la relation éducative, les relations professionnelles (travail social, pédagogie, services publics) ou des activités bénévoles (télé-acceuil, conseil conjugal, visiteurs de prison, apostolat religieux, etc.).L’écoute devient une valeur sociale ; elle a remplacé l’amour de l’héritage chrétien. Si les écoutants veulent acquérir dans l’exercice de leur profession ou de leur activité bénévole cette qualité d’écoute centrée sur la parole, il me semble nécessaire qu’ils s’y forment et qu’ils comprennent mieux de quoi il s’agit.Il n’y a pas que les psychanalystes qui insistent sur une écoute particulière ; d’autres cliniciens ont tenté de la cerner et de la définir, par exemple Ludwig Binswanger et Carl Rogers. Bien que ces modèles soient différents dans le temps et dans l’espace, ils ont en commun de ramener l’entretien clinique à sa dimension essentielle : la présence, comme problème humain fondamental.Ce qui est intéressant, c’est que ces deux modèles diffèrent du modèle psychanalytique en ne faisant pas l’hypothèse de l’inconscient, ce qui peut ouvrir les yeux du lecteur dans la mesure où tout le monde ne peut pas tenir compte de l’inconscient comme les psychanalystes le font.Par contre, si Rogers vise une relation immédiate authentique, Binswanger tient compte à la fois du rôle particulier que joue le médecin dans la relation et de ce qui est peut-être « implicite » chez le patient.Le modèle de l’analyse existentielle de Ludwig Binswanger s’est développé surtout dans la pratique psychiatrique à partir d’une conception philosophique : la phénoménologie.L’inconvénient du modèle, c’est qu’il implique une formation clinique et philosophique sérieuse. Le modèle de la méthode centrée sur le client de Carl Rogers, s’est mis en place aux USA surtout dans des situations de consultations cliniques en centre de guidance. Il est assez facile à apprendre et à comprendre et s’est développé dans de multiples situations d’aide psychologique, professionnelle ou non.Un modèle simplifié : l’écoute centrée sur le clientRogers fournit dans la deuxième partie de Psychothérapie et relations humaines, les éléments de sa biographie qui permettent de comprendre son œuvre. Il est né à Chicago en 1902. Il mourra en février 1987. Quand il a douze ans, sa famille s’installe à la campagne pour exploiter une ferme.Ses parents sont des protestants austères. Il entreprend d’abord des études d’agronome, et adhère au mouvement des jeunes gens chrétiens (Y.M.C.A.), et fait un voyage en Chine. Il découvre que l’agronomie n’est pas pour lui. Il abandonne la religion sévère de ses parents et commence des études de philosophie et de théologie à New York.Il y apprend la liberté de pensée, abandonne ses études religieuses et entreprend des séminaires de pédagogie. Il s’y initie à la pensée de John Dewey et à la psychologie clinique. Il fait un stage dans un institut de guidance infantile où les idées de Freud se sont répandues.Son travail consiste surtout dans la prévention de la cruauté envers les enfants. Il y apprend le métier de thérapeute. L’influence d’Otto Rank y est très forte, et Rogers se trouve rapidement dégoûté de la directivité dans les cures. Il est partagé entre le freudisme et la psychologie expérimentale. À vingt-cinq ans, il devient directeur d’une clinique psychopédagogique à Rochester pendant douze ans.Il se sent déchiré entre des exigences théoriques de recherche et les problèmes pédagogiques concrets des enfants qui ont des problèmes.Il finit par renoncer aux méthodes d’investigation et d’interprétation analytiques et cherche sa propre voie en s’inspirant de la psychologie existentielle, tel qu’elle s’est répandue aux USA par l’intermédiaire des psychiatres et philosophes qui fuient l’Allemagne nazie. En 1940, il est nommé professeur à l’Ohio State University. Pendant cette période, il rédigea les principes directeurs de sa méthode psychothérapeutique (Counseling and psychotherapy).Il est alors nommé à l’Université de Chicago. Il y fonde un centre de conseil pour étudiants. De nombreux étudiants de différents domaines viennent suivre son enseignement : psychologie clinique, pédagogie, travail social, psychologie industrielle. Il a pris l’habitude d’enregistrer et de transcrire ses cas de psychothérapie.Le principe général qui s’est dessiné au cours de ces années c’est qu’il faut créer un climat de compréhension et d’acceptation tel que le client puisse lui-même penser ses problèmes autrement et diriger sa vie. Il appellera d’abord sa méthode « non directive », croyant par là se distinguer de façon originale de la méthode freudienne, dont il pense qu’elle est nécessairement directive.En fait la méthode freudienne est essentiellement non directive au sens large, et c’est même là son originalité par rapport aux méthodes hypnotique et cathartique, rompant avec le modèle médical.En instituant les « associations libres » Freud inaugure une nouvelle voie thérapeutique. Mais il est vrai que l’empressement de Rank et des Américains a transformé la méthodologie.Rogers préférera finalement l’appellation de « méthode centrée sur le client ». Elle repose sur une conception de l’homme fondamentalement différente de celle de Freud. Pour Rogers tout individu possède une capacité à l’autodéveloppement et une tendance spontanée à l’intégration, c’est-à-dire à l’harmonie entre son expérience et sa conscience.Rogers collaborera à différents programmes de recherches et de formation aux USA. Il est lu à l’étranger. Il rassemblera ses idées pédagogiques dans deux ouvrages majeurs : Le développement de la personne, 1961 et Liberté pour apprendre, 1969. Paradoxalement ses dernières recherches sont devenues parfaitement béhavioristes, étudiant minutieusement à partir des enregistrements chaque élément d’un entretien. Ses dernières publications importantes portent sur les groupes de rencontre.« La psychothérapie est un processus par lequel l’homme devient son organisme », dit Rogers. Au-delà de sa pensée, c’est toute la tendance des méthodes existentielles humanistes qui se révèle ici : authenticité de ce qui se donne à voir, sans cadre préalable, intérêt pour le surgissement du vécu tel quel, sans décodage a priori. Mais Rogers va formaliser une méthode à partir des observations d’interviews. Elle repose sur des principes généraux qui dégagent un objectif général et une série d’attitudes à acquérir par le thérapeute.
• Le premier principe de non-directivité s’énoncera d’abord comme absence des diverses formes de direction dans l’entretien (questions, interprétations, conseils). Sous cet énoncé, Rogers visait surtout à s’opposer aux directives des cures américaines qu’il a connues. Il s’avéra vite que ce vocable était ambigu. En effet, il est impossible qu’il n’y ait aucune directivité dans une thérapie, mais surtout les formateurs s’aperçurent que les thérapeutes avaient tendance à « jouer » au thérapeute non directif, et que les effets attendus étaient inexistants.• Il énoncera ensuite le principe de la centration sur le client. Désormais, ce qui compte dans une psychothérapie, ce n’est plus l’absence de directives, mais la présence, chez le thérapeute, de certaines attitudes vis-à-vis du client et d’une certaine conception des relations humaines. Il met l’accent ici sur une manière d’être plutôt que sur une façon d’agir. Le comportement du thérapeute doit reposer sur des convictions profondément enracinées dans sa personnalité, faute de quoi il ne déclenchera pas chez le patient le processus d’actualisation de soi ou de croissance personnelle.• Le principe d’expérience ou « experiencing » qui vise la suppression de la distance à l’expérience immédiate, entre le vécu et l’exprimé. Cette notion rejoint le présent vivant dans l’ici et maintenant des thérapeutes existentiels (Ronald Laing) où l’autre est co-présent ; on l’appelle aussi « l’eccéité ». Cela suppose l’acceptation inconditionnelle.• Le principe de la relation authentique ou de la compréhension inconditionnelle et respectueuse. La relation vraie implique un engagement affectif positif du thérapeute dans la relation. C’est la condition pour que le client puisse accéder à son expérience spécifique. Rogers parlera d’un amour thérapeutique. Sur ce point, Moreno le rejoindra.• La congruence ou la perception du client. Ce principe vise la lucidité du thérapeute. Il ressent en lui-même, consciemment, et manifeste ses sentiments et ses émotions dans la relation. Il ne joue pas un rôle, il n’exerce pas une fonction, il ne s’identifie pas à un personnage idéal, ou à un thérapeute parfait, il ne joue pas à l’impassibilité ; il est transparent.Remarquons que Binswanger, pour sa part, a vu la difficulté en distinguant cette attitude de présence du rôle dans lequel on est, et en établissant une tension dialectique entre les deux. Rogers ne peut pas formaliser cette tension et supprime le rôle explicitement, ce qui fait dériver la présence vers une attitude idéale, incompatible avec une fonction professionnelle. J’ai indiqué que je préférais me ranger au point de vue de Binswanger.• Le principe d’empathie. C’est finalement le principe majeur et le concept clé de toute la méthodologie. Ce n’est pas de la sympathie, mais une sorte d’identification profonde de l’autre, mais non pas à l’autre. Ce n’est donc pas une fusion identificatoire, mais une sorte de reconnaissance intégrale de l’expérience de l’autre, avec son cadre de référence, ses valeurs. Il faut saisir ce que le client éprouve, instant par instant, dans son monde intérieur, comment il voit, comment il sent, comment il comprend. Le voir, le sentir et le comprendre avec ses yeux à lui. On n’est pas loin d’un amour idéal qu’on retrouvera dans la phase mystique de Moreno.• Le développement de son potentiel (maturation, growth) ou la considération positive de l’autre. Le thérapeute se défend de juger et s’interdit d’intervenir pour débloquer le client. Il n’impose aucune direction, mais laisse le client suivre son propre processus de maturation. C’est l’équivalent du principe de spontanéité de Moreno.
Les béhavioristes ont montré que malgré tout le thérapeute rogérien, sans s’en rendre compte, renforce positivement certaines attitudes ou sentiments du client et donc finit par imposer par conditionnement des normes, même si elles ne sont pas conscientes.Pour Rogers, la non-directivité est la condition de maturation et de développement de la personne du client dans le climat positif de la relation.Ces principes généraux débouchent méthodologiquement sur des attitudes. Il s’agit donc moins d’une façon d’agir que d’une façon d’être. « Si le comportement du thérapeute n’est pas l'expression de certaines attitudes et convictions profondément enracinées dans sa personnalité, il n’arrivera pas à déclencher, chez le client, le genre de processus appelé "actualisation de soi" ou "croissance personnelle" ».Quelques exemples de ces attitudes suffisent à indiquer que, finalement, elles visent toutes le même but : l’empathie : être inconditionnellement positif, s’abstenir de jugement, s’abstenir d’introduire une structure de pensée dans le champ d’expérience du client, s’abstenir de diriger le processus d’information sur lui-même, être authentique, en accord avec soi-même, avoir une compréhension empathique, être tolérant, respecter inconditionnellement, accepter inconditionnellement.Le problème est surtout que ces attitudes, sur lesquelles repose toute la méthode, sont toujours insuffisamment vérifiables. Ceci fait de la thérapie rogérienne une idéologie optimiste.Certes, les attitudes préconisées sont évidemment intéressantes à promouvoir dans l’approche clinique, mais elles sont insuffisantes à expliquer comment des troubles psychologiques peuvent se résoudre quand le client se trouve mis dans un tel climat relationnel.Si Rogers a fait voir à un grand nombre de gens que l’approche clinique implique une rencontre authentiquement humaine, ce que la pratique médicale ne montre pas assez actuellement, il fait porter tout le poids de la réussite du processus thérapeutique sur la personne du thérapeute, ou, en quelque sorte, sur le milieu relationnel, niant implicitement du même coup la négativité au cœur même de la structure humaine.On peut évidemment toujours dire que s’il y avait plus d’amour, il y aurait moins de misères. Mais pourquoi n’y a-t-il pas plus d’amour ?___Source : Bernard Robinson - Psychologie clinique - de boeck.___Article lié : La pratique clinique
0
commentaires